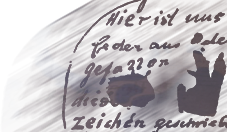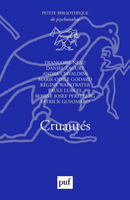
Quels rapports entre les tortures que s’inflige le patient mélancolique, l’enfant « facilement cruel » avec les animaux ou ses petits camarades et « l’amour impitoyable », dont parle Winnicott, entre le nourrisson et sa mère ?
Quels rapports entre les tourments qu’impose le violeur à sa victime, les meurtres des tueurs en série et ceux des génocidaires du Rwanda ?
Quels récits faire de la cruauté – par exemple de la cruauté nazie, comme prétend le faire Jonathan Littell dans Les Bienveillantes – sans la redoubler ?
Bien qu’elle traverse l’œuvre de Freud sous des formes variées, la notion de cruauté n’appartient pas au vocabulaire de la psychanalyse. Pourtant, à l’énigme de la cruauté, figure d’un mal radical qui décourage la pensée, des psychanalystes apportent ici un éclairage original. Violence inutilisable, haine superflue ou indifférence extrême, interne ou exercée à même le corps de l’autre, la cruauté s’avère paradoxale : elle révèle à la fois l’intime du sexuel et une dynamique pulsionnelle distincte. Seule la pitié, ou la compassion, peut y faire barrage – mais une vraie pitié, celle qui aurait fait l’épreuve de la cruauté : la sienne, et celle des autres.
Sous la direction de Françoise Neau
Avec André Ciavaldini, Marie-Odile Godard, Patrick Guyomard, Paule Lurcel, Rosine Josef Perelberg, Régine Waintrater, Daniel Zagury.
Petite bibliothèque de psychanalyse, PUF.
Parution : 15 janvier 2014
Sommaire
- Introduction : Figures freudiennes de la cruauté, Françoise Neau
- Le travail psychique du crime chez les tueurs en série et les acteurs de génocide, Daniel Zagury
- De la violence sexuelle et de sa cruauté, André Ciavaldini
- Aux sources de la Nyabarongo. Des mots à la cruauté, Marie-Odile Godard
- Les Bienveillantes, un livre sur le mal ?, Régine Waintrater
- Parcours du meurtre et du féminin : Une lecture du livre de Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Paule Lurcel
- « Un père est battu », Rosine Josef Perelberg
- Sans pitié, Patrick Guyomard