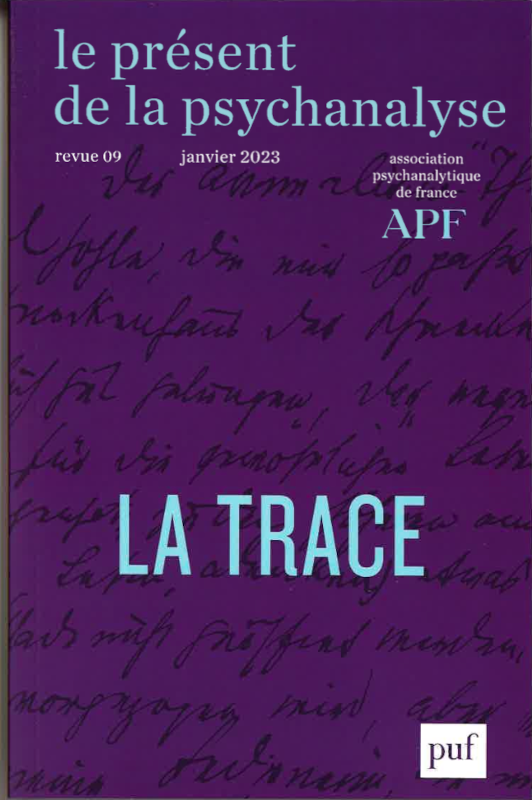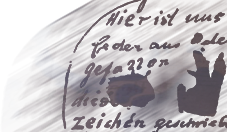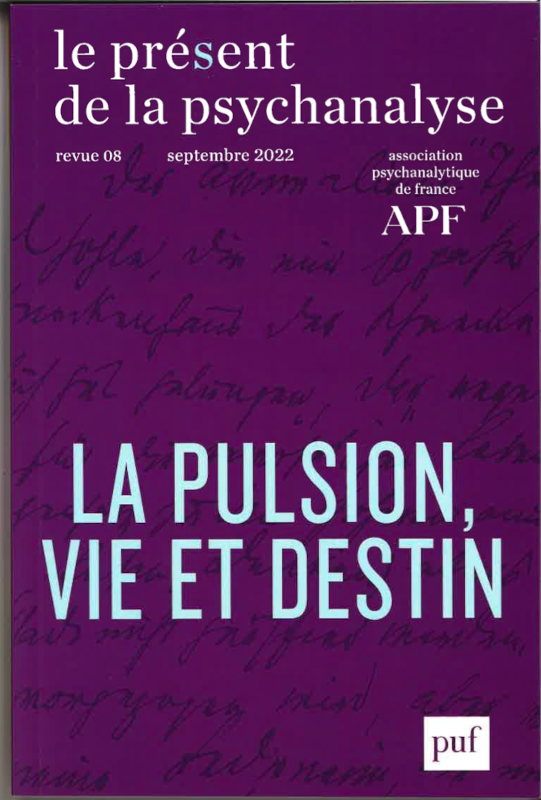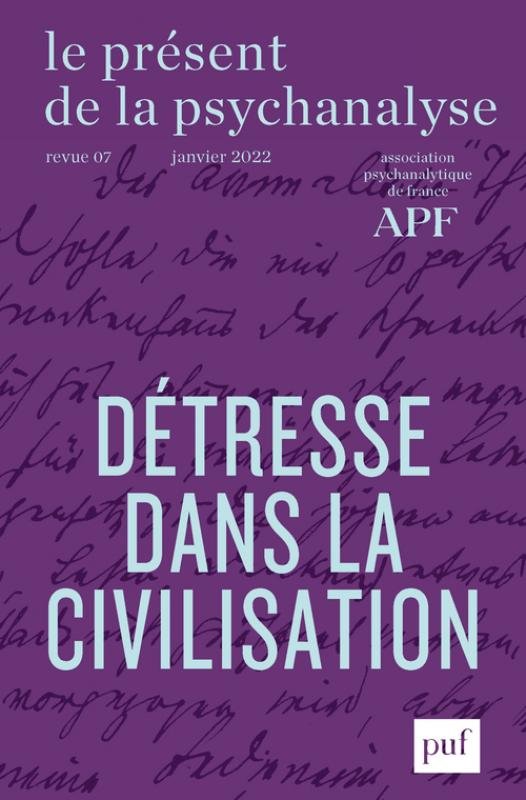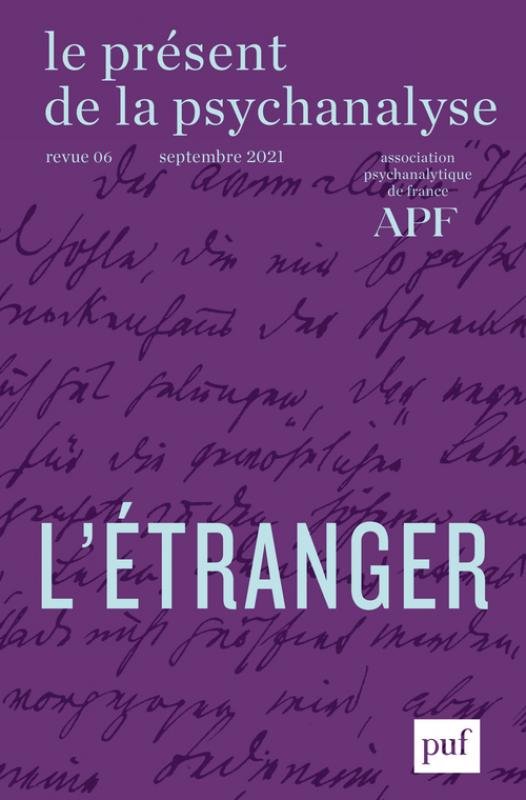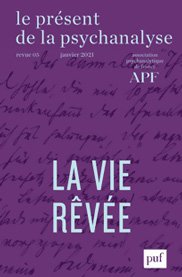La trace (2023)
Freud souligne à deux reprises son incapacité à effacer les traces, celles de la psychogenèse de deux ouvrages :
L’interprétation du rêve et L’homme MoÏse
Près de 40 ans séparent les deux livres, mais une même figure les réunit : Le père (celui de Sigmund et celui des Juifs), sa mort, l’ambivalence de l’amour et de la haine, une haine qui ne demande qu’à confondre la mort et le meurtre. Il n’y a pas de crime parfait, on n’efface jamais complètement les traces. C’est la chance de la psychanalyse. Relever les traces, suivre la piste dont ils indiquent l’entrée, interpréter les signes…
Le psychanalyste est un traqueur (un chasseur ?), même s’il est prié de ne pas tracer trop vite.
Collection : Le présent de la psychanalyse
Discipline : Psychologie et Psychanalyse
Date de parution : 15/01/2023
Les auteurs
LAURENCE KAHN
FRANCOISE LAURENT
JEAN-MICHELLÉVY
ALEXANDRE MOREL
PHILIPPE QUÉMÉRÉ
JEAN-MICHE REY
BRIGITTE ÉOCHE-DUVAL
BERNARD DE LA GORCE
JEAN-FRANÇOIS SOLAL
ISBN:
La pulsion, vie et destin (2022)
Issus de l’expérience dont la pensée cherche à se saisir, les concepts psychanalytiques sont des êtres vivants, perfectibles, évolutifs, dont le destin varie selon l’usage qui en est fait dans le cadre de réflexions théoriques, en interaction constante avec la pratique, de même qu’ils interfèrent inévitablement avec la façon dont la culture s’en empare… pour le meilleur et pour le pire.
« La pulsion pourquoi faire ? », « Pulsion, vie et destin » (2022) sont les titres de colloques qui, à plusieurs dizaines d’années d’intervalle, interrogent ce lien entre le concept, l’utilisation qui en est faite et son devenir.
Collection : Le présent de la psychanalyse
Discipline : Psychologie et Psychanalyse
Date de parution : 15/09/2022
Code ISBN : 978-2-13-083494-6
Les auteurs
Pulsion,viee tdestin
JACQUES ANDRÉ
ANDRÉ BEETSCHEN
PASCALE MICHON
RAFFAITIN
CATHERINECHABERT
Lapulsionpourquoifaire? (textes republiése nannexe)
DIDIER ANZIEU
JEAN LAPLANCHE
DANIEL WIDLÖCHER
ROGERDOREY(discussion)
Détresse dans la civilisation (2022)
Détresse dans la civilisation… Serait-il de nouveau possible de mettre « civilisation » au singulier ? Pas celui d’une même Cité, mais celui d’une même planète. La menace du désastre écologique est à la source d’un nouvel universalisme… dont on se serait bien passé. Le confinement de la vie auquel contraint l’actuelle pandémie est à la fois une réalité mondialisée et comme l’augure d’une vie future restreinte.
(suite…)
Malaise dans la culture (ou la civilisation), publié fin 1929, se conclut par cette interrogation : « La question décisive pour le destin de l’espèce humaine me semble être de savoir si et dans quelle mesure son développement culturel réussira à se rendre maître de la perturbation apportée à la vie en commun par l’humaine pulsion d’agression et d’auto-anéantissement. » Les motifs historiques ont changé, il est d’autant plus remarquable que notre question soit restée la même.
Comment comprendre une telle inaptitude à l’autoconservation, voire une mise en doute de la pertinence d’une telle notion quand il s’agit d’humanité ? La pulsion d’auto-anéantissement n’est-elle que la face négative d’une autoconservation perdue ? Ou relève-t-elle d’une violence positive et autonome, un au-delà du mal où le sadisme profiterait des circonstances ?
« L’époque présente mérite peut-être un intérêt particulier, écrit Freud. Les hommes sont maintenant parvenus si loin dans la domination des forces de la nature qu’avec l’aide de ces dernières il leur est facile de s’exterminer les uns les autres jusqu’au dernier. Ils le savent, de là une bonne part de leur inquiétude présente, de leur malheur, de leur fond d’angoisse. » Ce qu’il ne pouvait prévoir, c’est que cette nature « forcée », devenue trop humaine, allait se retourner contre son démiurge.
Comme il était sans doute difficile à Freud de conclure sur un mot aussi pessimiste, mais dont il ne mesurait pas à quel point il était prophétique des quelques années à venir, il ajouta une phrase d’espoir : « Et maintenant il faut s’attendre à ce que l’autre des deux “puissances célestes”, l’Éros éternel, fasse un effort pour s’affirmer dans le combat contre son adversaire tout aussi immortel. » Éros le rassembleur (sinon le démocrate !) contre la pulsion d’auto-anéantissement, l’amour contre la discorde, cette idée d’un antagonisme au principe de l’humanité est aussi vieille qu’Empédocle. Nous y sommes.
Collection : Le présent de la psychanalyse
Discipline : Psychologie et Psychanalyse
Date de parution : 31/12/2021
Code ISBN : 978-2-13-083493-9
(Réduire)
Les auteurs
Alain Ehrenberg – « Le malaise français de l’autonomie »
Mathilde Girard – « La séparation du monde »
Pierre-Henri Castel – « Psychanalyse des comportements génocidaires »
Patrick Mérot – « L’ère du complot »
Philippe Valon – « Trouble dans le genre ou malaise dans la différence ? »
Entretien avec Jean-Pierre Dupuy »
Nathalie Zaltzman – « Homo sacer »
L’Étranger (2021)
L’inconscient parle toujours une langue étrangère, y compris à celui qui en est l’hôte. Et il ne parle pas toujours… C’est d’abord comme « corps étranger », coupé de « la vie de représentation » que Freud l’évoque. (suite…)
Étranger (fremd), étranger au moi (ichfremd), corps étranger (Fremdkörper), le devenir-étranger (Entfremdung), étrangeté (Fremdartigkeit), inquiétante étrangeté (Unheimlich)… le lexique freudien, et avec lui l’expérience de la psychanalyse, déclinent « l’étranger » sur tous les tons. « Le dehors, l’étranger, l’ennemi furent jadis des concepts identiques ». Au-dehors comme au-dedans le plus intime, l’étranger est ce qui nous est le plus proche. Il menace nos frontières, alors qu’il vit déjà au plus secret de nous-mêmes.
(Réduire)
Les auteurs
Miguel de Azambuja, Houria Abdelouahed, Jean-Yves Tamet, Jacques André, Michel Gribinski, Alexandrine Schniewind, Philippe Valon, Francine Caraman, Léa Veinstein, André Beetschen, Catherine Chabert, Clarisse Baruch, Bruno Karsenti
DOSSIER
- Miguel de Azambuja, Tenir le trouble : quelques fragments sur l’étranger
- Houria Abdelouahed, Sur les sentiers du natal
- Jean-Yves Tamet, Quand l’étranger fait retour
- Jacques André, La femme étrangère
- Michel Gribinski, Un petit fait vrai
- Alexandrine Schniewind, Sehnsucht, un désir en attente
- Philippe Valon, Le psychodrame dit psychanalytique et le contre-transfert. Deux étrangers dans la psychanalyse
- Francine Caraman, Genre, exil et terre de l’entre-deux
- Léa Veinstein, L’étranger, c’est celui disparaît. Sur L’Amérique de Franz Kafka
Autres contributeurs
- André Beetschen
- Catherine Chabert
- Clarisse Baruch
- Entretien avec Bruno Karsenti
La vie rêvée (2021)
Le rêve fondateur de Freud, celui d’une vie onirique tout entière au service de l’accomplissement de désir, ce rêve ne s’est pas brisé, il s’est compliqué, voire déformé. À quoi travaille le rêve ? (suite…)
À déguiser un désir aussi inconscient qu’infantile afin de lui permettre de trouver le chemin vers la surface, fût-elle nocturne ? Ou à traiter, transformer un trauma passé ou actuel, sinon pour le « guérir », au moins pour en diminuer la force de destruction et l’implacable répétition ? Accomplir un désir ou prendre soin ? Ouverte par Freud (on peut rêver au-delà du principe de plaisir), la question n’a pas pris une ride. La voie royale du rêve mène toujours à la démesure de la vie psychique, que la source puise au sexuel le plus inconciliable ou à la destructivité la plus obscure.
« Peut-être l’inconscient ne dort-il jamais… » Surtout pas la nuit.
(Réduire)
Les auteurs
Jacques André, Didier Anzieu, Leopoldo Bleger, Bruno Gelas, Michel Gribinski, Udo Hock, Laurence Kahn, Josef Ludin, Jean-Claude Rolland, Alexandrine Schniewind
• Présentation
• Leopoldo Bleger, Espace du rêve, espace de la séance
• Jacques André, Une psychanalyse de rêve
• Jean-Claude Rolland, Le rêveur à son métier
• Bruno Gelas, Rêve, fiction, récit
• Alexandrine Schniewind, Le rêve bâtard des philosophes antiques
• Didier Anzieu, Les Esquimaux et les songes
• Michel Gribinski, Si la déformation est une ouverture
• Josef Ludin, La déformation et le destin
• Udo Hock, La déformation (Entstellung), un concept fondamental de la psychanalyse
• Laurence Kahn, Un petit pan de réel