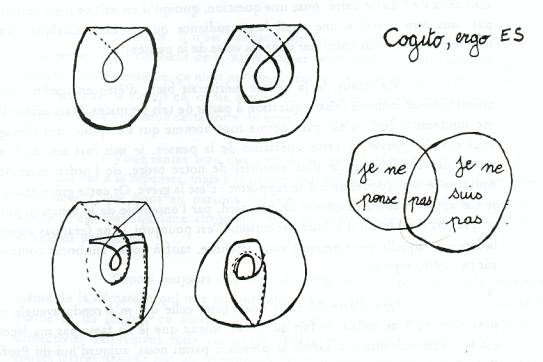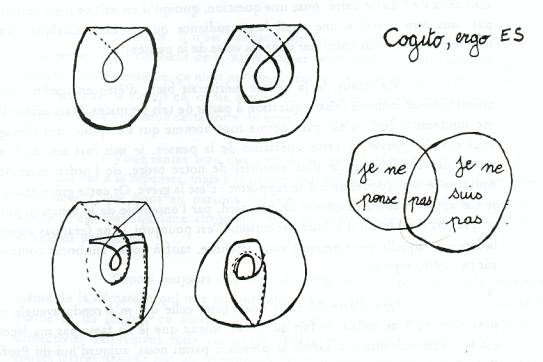J.LACAN
gaogoa
XIV-LOGIQUE
du FANTASME- 1966-1967
version
rue CB
1 Février
1967
note
(p111->)
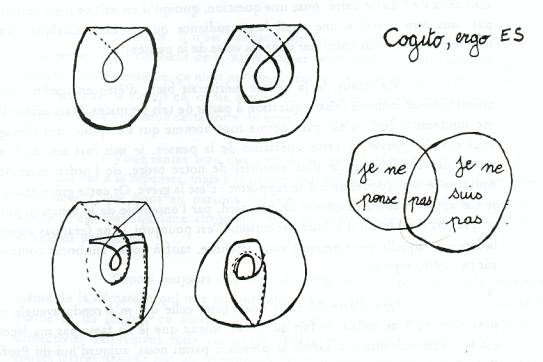
Je
vous remercie d’être venus aussi nombreux aujourd’hui alors que nous
sommes, personne ne l’ignore, un jour de grève. Je vous remercie d’autant
plus que j’ai aussi à m’en excuser puisque c’est sur l’annonce que
j’ai faite que je ferai ce qu’on appelle mon séminaire que
certainement une partie des personnes qui sont ici y sont. J’avais en effet
l’intention de le faire, de le faire sur le thème humoristique.
J’avais
écrit en haut ce Cogito Ergo Es, qui, comme vous le soupçonnez est un
jeu de mot et joue sur l’homonymie, l’homophonie approximative du Es
latin et Es allemand qui désigne ce que vous savez dans Freud, à savoir
ce qu’on a traduit en Français par la fonction du
Ca.
(lire
: ça )
Sur
une logique qui n’est pas une logique, qui est une logique totalement
inédite, une logique à laquelle je n’ai pas encore donné, je n’ai
pas voulu donner, avant qu’elle ne soit instaurée sa dénomination.
J’en tiens une qui me semble valable par devers moi, encore est-il apparu
convenable d’attendre de lui avoir donné un suffisant développement pour lui
donner sa désignation. Sur une logique dont le départ curieux, le fait de ce
choix (p->112) aliénant, soulignai-je, qui
vous est offert d’un « je ne pense pas »,
à un « je ne
suis pas », on peut se demander quelle est la place du fait que nous
sommes ici pour quelque chose qui pourrait bien s’appeler un « nous
pensons ». Déjà ça nous mènerait loin, puisque ce nous sûrement, vous
le sentez, dans les chemins où je m’avance qui sont ceux de l’Autre
barré, pose une question, quoiqu’il en soit ce n’est certainement
pas sans être motif à une aussi large audience que je fasse quelque chose qui
ressemble fort à vous entraîner dans les voies de la pensée.
Ce
statut de la pensée mériterait bien, d’être en quelque sorte, au moins
indiqué, comme faisant question à partir de tels prémices. Mais
aujourd’hui, je me limiterai à ceci ; c’est que comme tout homme qui
s’emploie, qui s’imagine en tous cas s’employer, à cette opération de la
pensée, je suis fort ami de l’ordre et qu’un des fondements le plus
essentiel de notre ordre, de l’ordre existant, c’est toujours le seul auquel
on a à se rapporter : c’est la grève. Or cette grève étant suivie, je
l’ai appris malheureusement un peu tard, par l’ensemble de la fonction
publique, je n’ai pas l’intention d’y faire exception. C’est pourquoi,
je ne ferai pas aujourd’hui la leçon à
laquelle vous pouviez vous attendre, sauf à vous l’annoncer comme telle, sur
ce Cogito ergo es.
Que
d’être ici pour une cause, celle qui m’a rendu aveugle un peu plus tard
qu’il ne fallait, le fait qu’il était mieux que je ne fasse pas ma leçon,
qui est la chose suivante : à savoir la présence parmi nous, aujourd’hui du
Professeur Roman JAKOBSON, auquel vous savez tous quelle est notre dette eu égard
à ce qui se poursuit ici comme enseignement. Il est arrivé à Paris hier soir,
il me fait l’honneur d’être mon hôte et je me faisais une joie de faire
devant lui ma leçon ordinaire. Il est bien d’accord avec moi, tout à fait
d’accord sur ceci : qu’il vaut mieux que je ne la fasse pas, à tout le
moins est-il venu ici et quiconque a ici une question à lui poser il est tout
prêt à y répondre; acte de courtoisie qui n’a rien à faire avec le
maintien aujourd’hui, de notre réunion.
Si
quelqu’un a le bon esprit d’avoir prête une question à poser nommément et
comme à lui-même, le Pr R. JAKOBSON, ici au premier rang, il a le temps
pendant que je vais de quelques mots amuser le tapis, de la mijoter pour tenir
en haleine, si la question est une véritable question, peut avoir un intérêt
pour tout le monde.
J’indiquerai
pour vous tenir en haleine quelle voie,
pourquoi seriez-vous si assidus si nous ne prévoyez pas à quel moment brûlant
la suite de notre discours nous conduit, comme j’avais déjà prévu que
mercredi prochain je ne ferai pas mon séminaire, c’est au 15
février que je vous donne rendez-vous, j’espère que le
fil ne se sera pas trop détendu, de ce qui nous unit cette année sur une ligne
d’attention.
Pour pointer ce dont il s’agit, ce cogito ergo es, vous voyez dans quel
sens il nous mène, et c’est une façon de
reposer la question de ce que c’est (p 113->)
que ce fameux « es »
qui ne va pas tout de même tellement de soi, puisque aussi bien je me
suis permis de qualifier d’imbéciles ceux qui trouvent trop aisément à
s’y retrouver, à voir une sorte d’autre sujet, pour tout dire, de moi
autrement constitué, de qualité suspecte, de mauvais moi, comme certains
l’ont tout crûment dit.
Bien
sûr, il n’est pas facile de donner son statut à une telle entité. Vous
pensez qu’il convient de le substantifier seulement de ce qui nous vient
d’une obscure poussée interne, ça n’est nullement écarter le problème du
statut de ce «es », car à la vérité, si c’était ça, ce ne serait
rien d’autre que ce qui depuis toujours très légitimement a constitué cette
sorte de sujet qu’on appelle le moi.
Vous
sentez bien que c’est à partir de l’Autre barré que nous allons
avoir non pas à le repenser, mais à le penser tout simplement, et que cet
Autre barré, pour autant que nous en partons comme du lieu où se situe
l’affirmation de la parole, c’est bien quelque chose qui met en question
pour nous le statut de la deuxième personne.
Depuis
toujours une sorte d’ambiguïté s’est instaurée de la nécessité même de
la démarche qui m’a fait introduire par la voie de fonction et champ de la
parole et du langage ce dont il s’agit concernant l’inconscient. Le terme
d’intersubjectivité assurément rôde encore et rôdera longtemps puisqu’il
y est écrit en toutes lettres dans ce qui fut le parcours de mon enseignement,
ce n’est jamais sans l’accompagner de
quelque réserve qui n’était pas pour l’auditoire que j’avais
intelligible alors que je me suis servi de ce terme d’intersubjectivité,
chacun sait qu’il n’est que trop aisément reçu
et que bien sûr, il restera la forteresse de tout ce que je combats de la façon
la plu précise.
Le
terme d’intersubjectivité avec les équivoques qu’il maintient dans
l’ordre psychologique est au premier plan précisément, celle que je désigne
comme dangereuse à marquer, à savoir : le statut de la réciprocité, rempart
de ce qui dans la psychologie est le plus fait pour asseoir toutes les méconnaissances
concernant le développement psychique. Pour vous le symboliser, le marquer en
quelque sorte, d’une image éclatante et grossière à la fois, je dirai que
le statut de la réciprocité en tant qu’il marque, que la maturité du sujet
s’instaurerait quelque part dans le développement, pour ceux qui auront vu ce
quelque chose, il y en a suffisamment dans l’assemblée pour que ma parole
porte, que les autres se renseignent, pour ceux qui ont lu ou vu au cinéma les
désarrois de l’élève Törless, je dirai que le statut de la réciprocité
c’est ce qui fait la bonne assiette, ce collège des professeurs qui supervisent, et qui ne veut rien savoir, n’avoir rien à toucher de cette
atroce histoire, ce qui ne rend que plus manifeste que pour ce qui est de la
formation d’un individu, et tout spécialement
d’un enfant, les éducateurs feraient mieux de s’enquérir de quelles sont
les meilleures voies qui lui permettent de se situer comme étant de par son
existence même, la proie des fantasmes de ses petits camarades avant de
chercher à s’apercevoir à quelle étape, à quel stade il sera capable de
considérer que le je et le tu sont réciproques.
(p114->) Voilà ce dont il s’agit dans
ce sur quoi nous avançons cette année sous le
nom de logique du fantasme, il s’agit de quelque chose qui emporte avec soi
des intérêts d’importance, bien sûr ceci ne va nullement dans le sens
d’un solipsisme, mais justement dans le sens de savoir ce dont il s’agit
concernant de grand Autre dont la place a été soutenue dans la
tradition philosophique par l’image de cet Autre divin vide que Pascal
désigne sous le nom de Dieu des philosophes et dont nous ne saurions absolument
plus nous contenter, ceci non pas pour des raisons de pensée, de libre pensée,
la libre pensée c’est comme la libre association, n’en parlons pas.
Si
nous sommes ici pour suivre le fil et la trace de la pensée de Freud, je
profite de l’occasion pour le dire, à savoir pour en finir avec une je ne
sais quelle forme de taon dont je pourrais à l’occasion me trouver la
victime désignée.
Ce
n’est pas la pensée de Freud au sens où l’historien de la philosophie
peut, fusse à l’aide de la critique de textes la plus attentive, la définir
au sens en fin de compte de la minimiser c’est-à-dire de faire remarquer
qu’en tel ou tel point, Freud n’est pas allé au-delà. On ne saurait lui
imputer quelque chose d’autre que je ne sais quelle faille, trou, reprise mal
faite en tel tournant de ce qu’il a énoncé.
Si Freud nous retient, ce n’est pas de ce qu’il a pensé en tant
qu’individu à tel détour de sa vie, ce qui nous intéresse c’est l’objet
qu’a découvert Freud. La pensée de Freud a pour nous son importance de ce
qui nous constatons qu’il n’y a pas de meilleure voie pour retrouver les arêtes
de cet objet, que d’en suivre la trace de cette pensée de Freud. Mais ce qui
légitime cette place que nous lui donnons c’est qu’à tout instant ces
traces vont nous marquer de façon d’autant
plus déchirante, d’autant plus que ces traces sont déchirées, que l’objet
dont il s’agit est de nous ramener à ceci, à savoir : qu’il s’agit de ne
pas le méconnaître. Ce qui est assurément la tendance irrésistible et
naturelle dans l’étape actuelle des choses de toute subjectivité constituée.
C’est bien ce qui redouble le drame de ceci qui s’appelle recherche
et dont vous savez aussi que le statut pour moi n’est pas sans être suspect,
nous sommes tout près d’y revenir et de reposer la question du statut que
nous pouvons donner à ce mot recherche derrière 1equel s’abrite chez nous la
plus grande mauvaise foi. Qu’est-ce que la recherche ? Rien d’autre que ce
que nous pouvons fonder comme l’origine radicale de la démarche de Freud
concernant son objet, rien d’autre ne peut nous donner que ce qui apparaît
comme le point de départ irréductible de la nouveauté freudienne, à savoir :
la répétition.
C’est
bien cette recherche qui est en quelque sorte répétée par la question que
soulève ce que j’appellerai nos rapports, à savoir ce qu’il en est d’un
enseignement qui suppose qu’il y a des sujets pour qui le nouveau statut du
sujet qu’implique l’objet freudien est réalisé; autrement dit qui suppose
qu’il y a des analystes, c’est-à-dire des sujets qui soutiendraient en
eux-mêmes quelque chose qui (p115->) se
rapproche d’aussi près que possible de ce nouveau statut du sujet, celui que
commande l’existence et la découverte de l’objet freudien. Le Sujet,
ce serait ceux qui soient à la hauteur de ceci : que l’autre, le grand
Autre traditionnel, n’existe pas, et pourtant il a bien une bedeutung,
cette bedeutung pour tous ceux qui m’ont jusqu’ici assez suivi pour
que les mots que j’emploie aient un sens, cette bedeutung, il suffit
que je l’épingle ici de ce quelque chose qui n’a pas d’autre nom que
celui-ci : à savoir la structure en tant qu’elle est réelle.
Si
je fais étaler ces images sur lesquelles devaient aujourd’hui courir ma leçon,
vous reconnaîtrez une fois de plus la bande de Möbius qui une fois coupée en
deux pour autant que ça ne la divise pas, la bande de Möbius une fois coupée
en deux qui se glisse en quelque sorte sur elle-même pour se redoubler de la façon
la plus aisée comme vous pouvez le constater, et à la fin du compte pour
obtenir ce quelque chose qui est parfaitement clos, qui a un dedans et un dehors
et qui est la quatrième figure, qui est celle d’un tore.
La
structure c’est que quelque chose qui est comme ça est réel. Ce qui est réel
sous le nom de structure est de la nature de ce qui est ici dessiné. Il y a en
quelque sorte une substance structurale que ceci n’est pas une métaphore, et
que c’est dans la mesure où à travers ceci est possible ce quelque chose que
nous pouvons réunir comme un ensemble du mot coupure, c’est ce à quoi nous
avons à faire est existant. Qu’en est-il d’un enseignement qui suppose lui
aussi, l’existence de ce qui n’existe pas, car il n’y a encore, selon
toute apparence, nul analyste qui puisse dire, supporter en lui-même cette
position du sujet.
Qu’est-ce
qui m’autorise à prendre la parole comme m’adressant à ces sujets encore
non existants ? Vous voyez que les choses ne sont pas sans être supportées
comme on le remarque en ricanant, de quelques suppositions dont le moins qu’on
puisse dire sont dramatiques, ce n’est pourtant pas pour en faire du
psychodrame. Nous avons à le clore d’une clôture logique.
Quel
que soit ce qui m’autorise, et peut-être pourrons-nous là-dessus en dire un
peu plus, il est clair que je ne suis pas seul, si j’avais à poser une
question moi-même au Pr R. JAKOBSON, je donne ma parole que je ne la lui ai même
pas en venant ici en voiture, laissé entrevoir, ce n’est pas qu’elle me
vienne maintenant, mais c’est maintenant qu’il me vient de la lui poser. Je
lui demanderai si lui, dont l’enseignement sur le langage a pour nous de
telles conséquences, il pense lui aussi que cet enseignement est de nature à
exiger un changement de position radicale au niveau de ce qui constitue le sujet
chez ceux qui le suivent.
Je
lui poserais aussi la question de savoir, c’est une question très ad
ominem, si du fait même de ce que comporte d’inflexion, je ne veux pas
employer de grands mots et je me garde de mots qui peuvent suggérer l’ambiguïté
qui s’attache au mot : ascèse, voire au mot qui traîne dans les romans de
science-fiction : de mutation, certes nous n’en sommes pas à ces balivernes
! Il s’agit du (p116->) sujet
logique et de ce qu’il comporte de discipline de pensée chez ceux qui à
cette position sont par leur pensée introduits, est-ce que si les choses pour
lui dans les conséquences de ce qu’il enseigne vont aussi loin ? Est-ce que
pour lui a un sens le mot disciple ? car je dirai pour moi, qu’il n’en a
pas. En droit, il est littéralement dissout, évaporé, par le mode de rapport
qu’inaugure une telle pensée, je veux dire que disciple peut être distingué
du mot de discipline. Si nous instaurons une discipline qui est aussi une
nouvelle haie dans la pensée, quelque chose qui le distingue de ceux qui
nous ont précédés en ceci : que notre parole n’exige pas de disciple.
Si Roman veut commencer par répondre à moi, si ça lui chante..........
Il
est décidé, que les personnes ayant des questions à poser, les présenteront
et M. Jakobson répondra ensuite.
Mme
AUBRY – Psychanalyste – Psychiatre infantile
Je
voulais demander, étant donné que je m’intéresse particulièrement aux
problèmes de difficultés de lecture et d’écriture, d’accession au langage
écrit, de sa valeur symbolique, si dans ces difficultés et en dehors des
erreurs qui peuvent être repérées comme des lapsus, il pense qu’une
structure du langage se rapporte à la structure même du sujet, ou plus
exactement à sa position vis-à-vis de l’autre.
Je m’explique par des exemples d’ordre clinique : je ne lis pas
l’allemand et je n’ai pu lire .........
J’en
ai retenu d’après ce qui m’en a été dit, que par exemple les confusions
des phonèmes :
B-P – D-P – M-N sont des confusions existant lors de l’apprentissage de la
parole, l’enfant apprenant les phonèmes dans un ordre déterminé en commençant
par les consonnes vocaliques, minimales communes à toutes les langues, puis élargissant
son registre dans un ordre constant selon les caractéristiques de la langue
maternelle.
Je
pensais que la persistance de telles confusions à l’âge de l’apprentissage
de la lecture pouvait marquer le désir de l’enfant de se maintenir dans cette
position infantile. Que ceci se rapporte aussi dans une certaine mesure à la
non accession au stade du miroir compris comme identification première,
narcissique, et avant qu’apparaisse le je.
Or
les carences maternelles, c’est-à-dire dans une certaine mesure l’absence
de discours de l’Autre, entre 6 et 18 mois déterminent l’incapacité
d’accéder au stade du miroir à l’image du corps propre, et naturellement
aux identifications. Elles ont pour corollaire constant, une déficience du
langage, et certaines particularités de structure du langage, lorsque l’unité
du son, du mot, de la phrase n’est pas respectée dans le langage oral comme
dans le langage écrit, si cette rupture n’est pas celle d’un lapsus, est-ce
qu’elle n’évoquerait pas l’image morcelée du corps et ce stade pré
narcissique ? De même les erreurs portant sur l’usage des pronoms personnels,
ressortiraient à l’incapacité à distinguer le je et l’autre,
l’incapacité (p117->) à distinguer les
verbes d’état et d’action, l’être et l’agir, répondrait à ce statut
non de sujet mais d’objet agi par l’autre. C’est la définition même
de l’aliénation.
Toutes
ces questions je me les pose non-seulement pour les dyslexies; mais pour
d’autres problèmes en particulier pour les psychoses de l’enfant avant le
stade du langage.
Une
dernière chose : l’inversion dans les syllabes de deux ou trois lettres
marquant effectivement une difficulté
d’organisation temporo-spatiale, mais tout enfant qui ne reconnaît
pas la droite et la gauche de son propre corps de celui de l’autre à des
chances d’avoir des difficultés à l’écrire. C’est plus évident encore
pour ceux qui écrivent en miroir. On peut supposer que l’enfant gaucher qu
rencontre toujours l’autre en miroir, aura plus de difficultés à franchir ce
cap et qu’au niveau de l’écriture la sénestralité favorise l’inversion.
Le moment de l’accession au langage écrit est en principe contemporain de la
résolution du complexe d’Oedipe où l’enfant dans la situation triangulaire
a accepté et reconnu la loi du père, symbolique en même temps que loi sociale
lorsque cette évolution n’est pas faite, est-ce que ce n’est pas là le
refus d’une incapacité d’accession au savoir et à la représentation
symbolique ?
Melle
L. IRIGARAY
Je
voudrais demander à M. Jakobson comme il fait l’articulation entre le sujet
de l’énonciation et le sujet de l’énoncé, ne croit-il pas qu’on peut
pourrait faire établir une différenciation dans les chifters en fonction de
cette articulation de l’énonciation à l’énoncé.
Dr
OURY :
Je
voudrais demander une précision à M. Jakobson, depuis quelque temps, dans les
problèmes d’analyse des groupes à l’intérieur des institutions on n'a pas
tellement d’outils, de concepts théoriques et on fait quelque fois usage
d’une façon peut-être hasardeuse de notions linguistiques; depuis quelque
temps, j’essaie d’introduire la notion de contexte pour essayer d’y voir
un peu plus clair dans ce qu’on pourrait appeler l’effet de sens à l’intérieur
d’un groupe. Cette notion de contexte, j’aimerais qu’on puisse la préciser
davantage, je veux donner simplement quelques points de repère : j’ai été frappé par l’usage assez pratique de
votre article sur la poétique, qui
pourrait être très utile dans la compréhension de ce qui se passe dans les
groupes. D’autre part, il semble que ce qui est en jeu dans une institution ce
sont des messages poétiques, c’est-à-dire une sorte de critique de
phonologisme, et la mise en place d’un passage qui tienne compte de la
syntaxe, autrement dit de la notion de message syntactique. Ce qui pose comme
problème : les relations entre le plan sémantique et le plan syntactique,
est-ce qu’il y a là un vrai problème, ou une série de faux problèmes ? En
particulier avec toutes les notions actuelles (p118)
d’opérateurs qu’on met en jeu entre le plan sémantique et le plan
syntactique, autrement dit, le remaniement syntactique, (c’est une image)
des structures d’un groupe, changent le message et donnent un certain sens à
ce qu’on fait dans l’institution.
En
restant dans cette perspective, est-il possible de mieux préciser la notion de
sujet de l’énonciation, cette notion de sujet de l’énonciation, peut-elle
s’articuler clairement avec cette notion de contexte d’une part, et de
message syntactique ?
M.
MEDEZE :
Ma question se situerait autour de la musique concrète,
c’est-à-dire la possibilité d’entendre quelque chose qui n’avait pas été
prévu, le support vocal hors de ce qui peut être de l’ordre du rébus, si le
support vocal est quelque part comme représentant d’une position du sujet
par rapport au corps de l’autre représenté dans sa voix.
Dr STOIANOFF :
Historiquement la dépendance prolongée d’un groupe ethnique sur un autre
pourrait-elle influer sur le langage du premier de façon
à ce qu’on obtienne un discours très particulier, comme dans la langue
bulgare.
Y a-t-il des facteurs historiques de dépendance qui pourraient expliquer cette
introduction dans la langue une façon de voir médiatisée.
M.
JAKOBSON :
Je
me sens dans une position assez difficile parce que je ne m’attendais pas à
parler, puisqu’il y a la grève que c’est moi qui devrais parler, en dehors
du contexte je ne sais pas ce qu’est une strike. Je répondrai plutôt en
bloc. Que la question qui me paraît surtout rapprocher la question de la
linguistique et de la psychanalyse, c’est vraiment celle du développement du
langage chez l’enfant. Là il y a des problèmes sur lesquels il faudra
travailler chacun des deux domaines, ces questions ont un rapport de
complémentarité. Il faut saisir les deux aspects.
Nous arrivons maintenant dans le domaine du langage enfantin, ce que nous
voyons de plus en plus, c’est le grand pourcentage des phénomènes
universels, l’universalité domine, que change même le problème de
l’enseignement du langage parce que nous voyons maintenant que pour saisir
n’importe quel langage, chaque enfant est préparé par un certain modèle inné,
car la limite entre la nature et la culture change de place, on a pensé que
dans la communication des animaux c’est uniquement le phénomène des
instincts, les phénomènes de la nature, tandis que chez l’homme c’est la
question de l’enseignement, de la culture. Il se montre que la chose est bien
plus compliquée. Qu’on a chez les animaux un grand
(p119
->) rôle de ce modèle inné, de ces prédispositions, de cette
possibilité d’apprendre la langue qui existe à un certain âge de
l’enfance, qui existe quelques mois après sa naissance, la possibilité
d’acquérir un code, et d’autre part, (c’est un phénomène plus curieux)
c’est qu’à un certain âge, l’enfant perd la capacité d’apprendre sa
première langue. Si l’enfant était dans une situation artificielle, dans les
premières années de sa vie où i1 n’aurait pas connu un langage humain il
peut le regagner entièrement, mis dans une situation normale, jusqu’à 7 ans
à peu près. Après 7 ans il ne sera plus capable d’apprendre la première
langue.
Tous
ces phénomènes sont importants et nous montrent que nous devons analyser
chaque étape de l’acquisition du langage du point de vue des phénomènes
biologiques, psychologiques et intrinsèquement linguistiques. Permettez-moi de
m’arrêter à 2 ou 3 problèmes touchés ici.
Lorsque
l’enfant commence à parler, il y a deux phénomènes tout à fait révolutionnaires
du point de vue de la mentalité de l’enfant. L’une de ces étapes est celle
de l’acquisition des pronoms personnels. C’est une grande généralisation
c’est la possibilité d’être moi en un instant, et d’entendre
l’autre devenir moi, vous connaissez cette discussion entre les
enfants qui lorsqu’ils apprennent les pronoms disent : ce n’est pas toi qui
es moi, c’est moi qui est moi et toi tu n’es que toi etc... D’autre part,
l’incapacité de certains enfants quand ils ont appris le pronom de la première
personne de parler d’eux-mêmes et de dire leur propre nom, car l’enfant
pour lui-même n’est que moi. Ces choses changent l’enfant complètement.
Je
me souviens lorsque des professeurs et Mme KAST qui sont venus au début de la
dernière guerre à Stockholm, m’ont montré un enfant qui était égocentrique
d’une façon étonnante, il voulait tout dominer, avoir toutes les maisons,
!es jouets, etc... Je l’ai étudié du point de vue linguistique et je me suis
aperçu qu’il n’avait aucune trace de pronom personnel: Je leur ai dit
enseignez-lui le pronom personnel, il saura ses limites, il saura que ce n’est
pas lui l’unique, qu’il y a l’échange, le moi n’est que
l’auteur du message en question. Ca a marché.
Il y a une autre opération, celle qui est la
question du changement dans la vie linguistique d’un enfant. Il y a un cas
connu qu’on connaît dans les pays très différents, d’un enfant de 3 ans
qui accourt vers son père et dit : le chat aboie, le chat : ouah, auah. Si le père
est pédant, il dit : non, c’est le chien qui boit et le chat qui fait miaou.
L’enfant pleure, on lui a détruit son jeu. Si le père au contraire dit :
oui, le chat aboie, maman dit miaou etc, l’enfant est très heureux. J’ai
raconté cette histoire à Cl. LEVY-STRAUSS, peu de temps après il a son garçon
qui avait trois ans à l’époque qui est venu faire
la même chose, LEVY-STRAUSS a voulu faire le père libéral, il n’a pas réussi,
car son fils considérait ce jeu comme un privilège d’enfant et le père a dû
parler d’une autre façon.
(p120->)
De quoi s’agit-il ? de la découverte que fait l’enfant à un certain âge,
1a découverte de la prédication. On peut attacher à un sujet un prédicat et
la chose essentielle est qu’on peut attacher au même sujet divers prédicats
et le même prédicat peut être employé par rapport aux divers sujets, le chat
court, dort, mange, il aboie aussi, la question est que l’enfant comprend
que la prédication ce n’est plus la dépendance d’un conte, la prédication
c’est déjà une liberté individuelle, alors l’enfant emploie de façon
exagérée cette liberté. L’enfant ne connaît pas la définition de la
liberté donnée par l’Impératrice Russe, CATHERINE, que la liberté
c’est le droit de faire ce que les lois permettent. Alors le chat aboie. Nous
retrouvons les mêmes problèmes dans l’aphasie, dans l’anthropologie parce
que dans certains peuples le fait d’attribuer des actions aux animaux, ou
d’attribuer les actions de certains types d’animaux aux autres, est considéré
comme un péché comme par exemple chez les Dayates, et qui est puni comme
l’inceste. C’est justement là que la liberté veut rompre la loi.
Si
on veut discuter sur la question du développement phonologique, nous nous
trouvons devant les mêmes problèmes de ces différents stades, et je pourrais
dans une discussion plus détaillée vous montrer les étapes, les règles
universelles, la possibilité de développer une certaine liberté parce qu’il
n’y a pas de règle universelle, il y a là aussi la question importante de
l’ordre temporel, non pas des acquisitions, mais l’ordre temporel d’une séquence,
d’une série, d’un groupe, des lois.
Pour
la lecture on se trouve dans un nouveau domaine, il ne faut pas oublier que la
lecture et l’écriture c’est toujours une super structure; une structure
secondaire, si on ne parle pas, c’est de la pathologie, si on ne lit pas,
c’est de l’analphabétisme (si on n’écrit pas non plus) d’après les
dernières statistiques de l’UNESCO dans 60 % de la population du
monde, ce phénomène existe.
Il ne faut pas oublier que ce sont des phénomènes complètement
différents, c’est-à-dire que l’écriture, la lecture, renvoient déjà à
la base qui est le langage parlé, mais ce qui ne veut pas dire que l’écriture
est simplement un miroir du langage parlé. Il y a de nouveaux problèmes qui
apparaissent, et l’un de ces problèmes, c’est la question de l’espace?.
L’écriture n’est pas seulement temporelle, mais aussi spatiale, et ce qui
apparaît c’est la question droite-gauche, gauche-droite, ça
introduit une quantité de principes nouveaux, qui du point de vue par
exemple, de la structure de l’écriture, ce qui est le plus intéressant
c’est l’analyse de différentes formes de dyslexies et d’agraphie. qui
montrent les mécanismes et les déviations individuelles et personnelles et les
déviations mentales, ces déviations sont en rapport.
Pour la question du rapport entre le problème sémantique et le problème
syntactique, je crois de plus en plus, que nous voyons l’opposition de ces
deux phénomènes qui risque de devenir trop rigides, dans le domaine
syntactique il s’agit d’ordre de combinaisons, de groupements, mais chaque
combinaison s’oppose (p121->)
à une autre combinaison possible et les rapports entre ces deux phénomènes
syntactiques est nécessairement un phénomène sémantique. Nous sommes aussi
nécessairement en même temps dans le domaine du sémantique et du syntactique
et du grammatical.
Il est impossible de séparer ces choses. Pour un linguiste en général, il n'y
a pas de phénomène dans le langage qui ne possède pas un aspect sémantique,
la signification est un phénomène qui concerne n'importe quel niveau de
langage, vous savez qu'il y a ce problème qui a été posé de très belle
façon, la plus belle peu-être dans l'ancienne doctrine des grammairiens et
philosophes du langage Hindou, c'est que la langue a plusieurs articulations, et
particulièrement une articulation selon cette vielle terminologie hindoue, la
double articulation des éléments qui ne sont pas significatifs mais qui sont
nécessaires pour construire des unités significatives.
Ces éléments qui ne sont pas significatifs, ils sont comme l'a bien dit les
hindous, et comme ça l'a été répété au Moyen-Age, dans la linguistique
moderne dès les années trente, c'est que les éléments sont distinctifs, et
participent à la signification, si on ne respecte pas ces éléments on obtient
l'effet d'une homonymie. La signification commence dès le début, et le
phénomène ou le trait distinctif, sont également des signes, des signes d'un
autre niveau, des signes auxiliaires, mais quand même des signes.
Si on me demande quel est le problème le plus actuel de la linguistique, le
problème interdisciplinaire, envers la psychologie, la psychanalyse,
l'ethnologie, c'est le problème du contexte.
Le contexte a deux aspects : le contexte verbalisé qui est donné dans le
discours et le contexte non verbalisé, la situation, le contexte non verbalisé
mais toujours verbalisable.
Je pense que cette question de verbalisation, je ne dis pas que la psychanalyse
se réduit au problème de la verbalisation, mais ce que la psychanalyse a
en commun avec la linguistique c'est que le problème de la verbalisation joue
le rôle essentiel, principal dans ces deux domaines. Maintenant au sujet de
l'énonciation et au sujet de l'énoncé, pour que cette distinction soit
atteinte, l'enfant a besoin d'élaborer les pronoms personnels, mais c'est un
problème plus compliqué.
C'est un problème en général de l'énonciation qui implique des citations, et
quand nous parlons, ou bien nous disons : Jean a dit ça, ou comme l'a dit Jean,
on prétend que, ou bien nous ne citons pas, mais nous disons des choses que
nous n'avons pas vues, et qui dans un certain ordre doivent avoir des suffixes
spéciaux, "nous l'avons entendu dire", nous n'avons pas vu comment
Jules César a été tué, mais si nous en parlons c'est que nous citons. Si
nous analysons mieux nos énonciations, nous nous apercevons que la question
des citations joue le rôle (p122->)
primaire, essentiel. L’oratio, direct, l’oratio obliquae,
ce sont des problèmes plus larges que la place qui leur est indiquée par
la grammaire classique. C’est un des problèmes qui n’est pas encore élucidé
jusqu’au bout. C’est une question que le psychanalyste et le linguiste
doivent travailler ensemble.
Un phénomène très curieux c’est qu’en Bulgare, on a de
différentes formes verbales pour indiquer le phénomène dont on est sûr
qu’on a vue et les phénomènes qu’on suppose, qu’on a ouï-dire. La
question se pose de savoir pourquoi en Bulgare cela a été développé, il y a
des raisons historiques à ce surgissement. C’est justement l’influence
d’une langue sur une autre langue : du Turc sur le Bulgare et sur certaines
autres langues. Question intéressante non seulement du point de vue historique,
mais du point de vue structural, chaque conte verbal, chaque langue n’est pas
une langue monolithique, chaque langue suppose plusieurs sub contes, et chez les
bilingues c’est la possibilité de parler en deux langues différentes, et il
n’y a pas de courtine de fer entre les deux langues qu’on emploie, il y a
l’interaction, le jeu des deux langues, il y a un phénomène important qui
joue un rôle, c’est comment une langue du bilingue change par l’autre
langue. Il y a une quantité de possibilités. C’est le prob1ème de notre
attitude envers les langues qu’on parle.
Si par exemple, je parle de ma génération des intellectuels russes, je
dois dire que pour notre génération, nous avons pu être bilingues, ou avoir
plusieurs langues : russe et allemand, russe et anglais, mais c’était une
impossibilité du code du russe d’employer dans le même message le russe et
l’anglais, le russe et l’allemand, introduire des mots, des expressions
allemandes dans une phrase russe était considéré comme un phénomène comique.
Tandis qu’on pouvait introduire tant de phrases, tant de mots français dans
le russe, comme vous le savez par la « guerre et la paix » de TOLSTOÏ, c’était possible. Ça choque parfois en France quand je dis du
point de vue de ma génération des intellectuels russes, le français n’était
pas une langue, mais simplement un style du russe parlé. C’est important ces
rapports entre les langues, ça montre que l’attitude est différente,
qu’un mot joue un grand rôle dans toute l’attitude non seulement envers les
langues et leur structure, envers la culture etc...
Cette
question de la complexité du code joue un rôle essentiel.
Par exemple ce phénomène bulgare qu’est-ce que ça
change ? Dans les phénomènes grammaticaux que nous employons, les phénomènes
grammaticaux qui apparaissent dans une langue, chacun a sa fonction, mais si on
parle l’autre langue on peut très bien exprimer ce qui est absent dans la
grammaire de la première langue. Si je parle du bulgare, le français ou le
russe : je peux très bien dire j’ai vu le bateau venir, ou bien je
crois que le bateau est arrivé. Il y a là une grande différence qui s’est
donnée dans la grammaire ou si c’est seulement une possibilité de
l’expliquer par des moyens lexicaux.
(p123->)
Pour illustrer cette différence j’emploie toujours un exemple très simple :
Si je raconte en anglais que j’ai passé la dernière soirée avec neighbour
avec un voisin. Si on me demande : est-ce que c’était un homme ou une femme ?
Je me dois de répondre : is not your business. Tandis que si je le dis en français
je dois dire que c’était un voisin ou une
voisine. Ce que nous devons dire et ce que nous pouvons omettre, ce n’est pas
ici dans cet auditoire que je dois expliquer l’énorme différence...
La question de mon ami que j’admire tellement et dont les
travaux sont pour moi toujours une source d’instruction, je me
sens, pour employer le mot du Docteur LACAN, je me sens son disciple. Je dois
dire que j’ai de grandes difficultés à répondre à sa question. Je voudrais
qu’il me la formule de façon plus brève, sinon sa demande pour
répondre (d’) un livre aussi volumineux que son dernier livre.
Je lui promets de répondre à cette question à mon prochain voyage à Paris.
Dr LACAN :
Est-ce que vous pensez qu’un linguiste formé à la
discipline linguistique, cela engendre chez lui une marque telle que son mode
d’abord de tous les problèmes est quelque chose qui porte un cachet
absolument original. Vous êtes celui qui transmettez cette sorte de discipline
qui est la plus proche de la nôtre, est-ce que
le mode de rapports que fait surgir chez vous, du fait que vous êtes celui qui
transmet cette discipline, est-ce que pour vous c’est quelque chose qui est de
la dimension de ce que c’est qu’être un disciple est quelque chose
d’essentiel d’exigible et qui compte pour vous.
Pr JAKOBSON :
Je répondrai à cette question de la même façon
que j’ai répondu à celle de la différence entre les structures
grammaticales des diverses langues. C’est possible pour un linguiste de tâcher
de cesser à certains moments, d’être seulement linguiste et de voir les
problèmes d’un autre côté, sous l’aspect d’un psychologue, d’un
anthropologue, etc. Tout cela est possible, mais la pression de la discipline
est énorme. Quel est le type mental du linguiste, c’est curieux qu’un
linguiste, ça n’existe presque pas, qu’on devient linguiste. Les
psychologues ont montré que les mathématiques, la musique, sont des préoccupations
des capacités qui apparaissent à l’âge enfantin, si vous lisez les
biographes des linguistes vous voyez qu’on les voit déjà prédisposés
à devenir linguistes à 6 – 7 -8 ans. C’est l’avis de Saussure, d’une
grande quantité de linguistes.
(p124->)
Qu’est-ce que ça veut dire ? Je me permets de dire que la grande majorité
des enfants sait très bien peindre et dessiner, mais à un certain âge, la
majorité perd cette capacité et ceux qui deviennent des peintres gardent une
certaine acquisition infantile, un certain trait infantile.
Le
linguiste c’est un homme qui garde une attitude infantile envers la langue,
que la langue elle-même intéresse le linguiste comme elle intéresse
l’enfant, elle devient pour lui le phénomène le plus essentiel dans
une complexité, et cela permet au linguiste de voir les rapports internes, les
lois structurales de la langue, mais il y a là aussi un danger, que le rapport
entre ce qui est le 1angage et les autres phénomènes peuvent êtres déformés
facilement, à cause de l’accent un peu trop unilatéral posé sur la langue.
C’est là qu’est 1a grande nécessité du travail qu’on appelle de ce
terme bien ambigu, bien vague mais important en même temps : celui de
l’interdisciplinaire.
Mes expériences à
New-York, mes rencontres avec les psychanalystes, un anthropologue comme LEVY-STRAUSS,
moi et quelques autres linguistes, quand nous discutions nos problèmes j’ai
vu qu’il était important de devenir pour un instant le disciple de ces autres
disciplines pour voir la langue de dehors comme on voit la terre de dehors en
montant dans un spoutnik.
note:
bien que relu, si vous découvrez des erreurs manifestes dans ce séminaire, ou
si vous souhaitez une précision sur le texte, je vous remercie par avance
de m'adresser un email. Haut
de Page
commentaire
texte
revu le 3 juin 2001