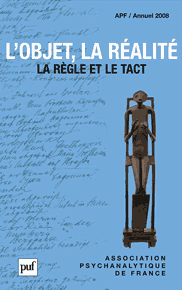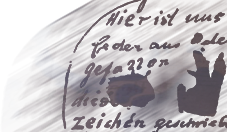L’objet, la réalité – La règle et le tact (2008)
Publication annuelle de l’Association psychanalytique de France, ce second volume, L’Annuel 2008, offre un choix de travaux et d’échanges scientifiques tenus au cours des deux dernières années. (suite…)
Sont présentées les conférences données aux Entretiens de Psychanalyse de l’APF, tenus en décembre 2006 sur le thème “La relation à l’objet”. Jean Laplanche, Michel de M’Uzan et Daniel Widlöcher font bouger les frontières de la notion d’objet en psychanalyse : revenant sur les controverses qui ont animé l’histoire de la pensée analytique, ils questionnent les diverses représentations de relation d’objet, d’objet-source, de choix d’objet et d’objet-figure. Josef Ludin, Adriana Helft et Dominique Scarfone s’associent au débat par leurs travaux sur les objets de l’identification et l’examen de réalité.
La “technique psychanalytique” est l’autre “objet” de cet Annuel 2008. Quatre exposés présentés dans un cycle intitulé “La règle et le tact” sont ici proposés. Le volume se conclut sur un texte rare de Sylvie Gribinski Nysenbaum, psychanalyste de l’APF prématurément décédée.
(Réduire)
Les auteurs
André Beetschen . Jean-Philippe Dubois . Sylvie Gribinski Nysenbaum . Adriana Helft . Jean Laplanche . Jean-Michel Lévy . Josef Ludin . Michel de M’Uzan . Dominique Scarfone . Dominique Suchet . Philippe Valon . Daniel Widlöcher
Le Primitif – Que devient la régression ? (2007)
Comment articuler, du point de vue psychanalytique, “primitif” et “régression” ?
Ce premier volume articule deux interrogations psychanalytiques, fondamentales depuis Freud.
L’une concerne la notion et l’étendue psychiques du primitif, dans ses formes persistantes et son enracinement culturel dans l’image et la langue. (suite…)
L’Annuel 2007 publie ici les exposés présentés aux Entretiens de psychanalyse de l’APF qui se tinrent en janvier 2006 et qui rendirent hommage à l’œuvre de Pierre Fédida, dont est présenté à nouveau le texte “Du rêve au langage”.
L’autre s’attache à divers modes d’exploration du primitif : non seulement par la régression dans l’expérience de la cure analytique, mais aussi par l’éclairage que proposent la recherche anthropologique ou la prise en compte de la violence sociale et politique de l’exil et de l’exclusion.
(Réduire)
Les auteurs
Jacques André . Claude Barazer . André Beetschen . Patrice Bidou . Dominique Clerc . Pierre Fédida . Edmundo Gómez Mango . Laurence Kahn . Jean-Claude Rolland . Hélène Trivouss-Widlöcher . Marcelo Viñar . Daniel Widlöcher
L’acte (2006)
L’acte, en psychanalyse, procède du faire et du dire. Le cantonner dans l’enclos de l’acting out ou le réduire à la simple action motrice reviendrait à abolir l’invention par Freud de l’inconscient, en tant qu’elle démantèle la conception psychologique de la conscience. Depuis les études sur l’hystérie jusqu’à l’Abrégé, l’événementialité psychique est conçue en termes d’actes. (suite…)
À l’orée de la découverte, la talking cure enracine la méthode dans la puissance des mots lorsqu’ils reviennent sur le lieu de l’incident psychique qui n’a pu être abréagi. Et dans ses derniers textes encore, Freud définit la tâche analytique et situe son effet thérapeutique dans la substitution d’actes psychiques conscients à des actes psychiques inconscients. D’où l’acte psychique inconscient tire-t-il un tel pouvoir ? à quoi tient, face à lui, la force du langage ? Comment survient l’acte de l’interprétation et comment celle-ci agit-elle ?
(Réduire)
Les auteurs
Laurence Apfelbaum . Jean-Claude Lavie . Danielle Margueritat . Daniel Widlöcher
Résistances (2005)
La résistance, c’est d’abord la résistance dans l’analyse, cet obstacle clinique qui dans l’espace de la cure est aussi le plus sûr outil pour accomplir le travail analytique. Entre la violence de l’interprétation, la menace de la suggestion, le refoulement et la compulsion de répétition, est-elle encore, dans la pratique et la théorie de la pratique, l’adversaire essentiel ? (suite…)
La résistance c’est aussi la résistance à l’analyse, le nom donné par Freud au refus du bouleversement qu’apportait la découverte d’un inconscient sexuel. Entre les mouvements d’assimilation, qui réussissent à dévorer leur objet sans reste, et les assauts toujours aussi vifs des procédures sociales et scientifiques normées, l’urgence n’est-elle pas aujourd’hui de mettre en oeuvre une résistance de l’analyse ? Quand l’état veut se saisir de la psychanalyse, quand tout le mouvement social pousse vers la garantie et la certification, cette résistance de la psychanalyse cesse d’être une question simplement interne aux sociétés de psychanalyse. Enfin, le mot même de « résistance » rend compte des enjeux qui ont dominé l’histoire du mouvement analytique. Parce que, dans l’histoire des hommes, des filiations, des théories, l’un des moteurs de la transmission est le conflit, l’histoire de la psychanalyse est marquée par des ruptures et des scissions. La naissance de l’APF s’est inscrite dans l’un de ces moments.
(Réduire)
Les auteurs
Catherine Chabert . François Gantheret . Michel Gribinski
Le fantasme : une invention ? (2004)
Le fantasme se constitue en s’éloignant de l’événement réel comme de l’imagination consciente et sa force d’attaque interne contraint à inventer son usage et son lieu. Comment tient-il ensemble la scène inconsciente, interprétée – construite dans « Un enfant est battu », et l’expression typique du roman familial ou des fantasmes originaires ? Pourquoi ce noyau de la réalité psychique garde-t-il l’ambiguïté topique qui le voue aux frontières. (suite…)
Inventer le fantasme, retrouver avec ces Entretiens les voies de son invention freudienne, c’est dévoiler dans son agencement scénique, où image et scénario accomplissent plus qu’ils ne racontent, l’effet d’une excitation pulsionnelle qui tantôt anime, tantôt contraint à la répétition immobile. C’est revenir sur les chemins de la sexualité infantile, sur les théories et la figuration qu’elle suscite, sur le jeu de l’activité de fantaisie qu’elle instaure.
Car le fantasme invente, aussi, les formes de la vie psychique. Et quand le transfert l’actualise en provocant inventivité, ou sidération, chez l’analyste, voilà qu’il nous faut deviner : avec cette excitation de pensée, de quel pas marchons-nous ?
(Réduire)
Les auteurs
Jean-Claude Arfouilloux . André Beetschen . Roger Dorey . Lucile Durrmeyer . Bernard Favarel-Garrigues . Pierre Fédida . Laurence Kahn . Josef Ludin . Dominique Maugendre . Patrick Merot . Aline Petitier . Evelyne Sechaud . Daniel Widlöcher